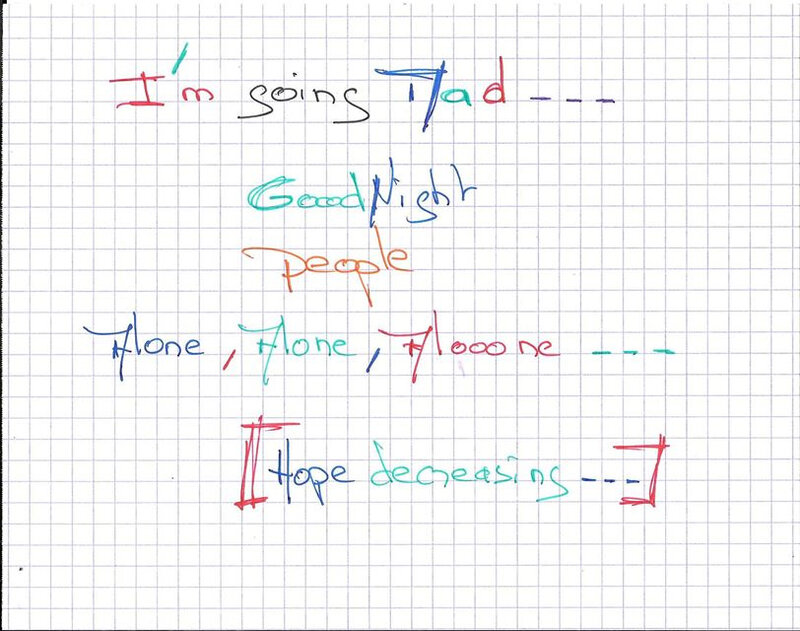Real Civitas
On n'est jamais débarrassé de la haine. Elle s'insinue, elle parasite toutes les questions ouvertes à propos de n'importe quel point de vue sur la nature humaine. On a beau se retenir, un crachin de mépris finit toujours par tomber sur les gens, êtres de seconde zone, terreau du manichéisme le plus sale, rebuts impossible à recycler... Au choix, qu'on se regarde ostensiblement ou qu'on regarde trop le mirage qui nous sert d'étalon pour juger du tout-un-chacun. Dans tous les cas on ne peut guère s'empêcher d'être lâche et/ou source d'indélicatesses faciles. Dans l'arrière-boutique de nos têtes se joue la bataille dont l'issu (a priori fatale) dictera notre opinion sur tout. La haine l'expurgera de la cave humide de nos idées refoulées et formera un regard à notre égard qui nous qualifiera comme plein d'un ostracisme sans fondement. On refait le monde, on l'arrange, on le rêve, peut-même qu'on le délire en appuyant sur cette petite particularité qui nous place plus haut sur l'échelle des vertus. Puis, par une bénédiction vorace, on retourne rapidement à notre insignifiance en fomentant toujours plus ces haines de soi comme de tout le reste. Voilà par où s'exécute le cercle vicieux. Pour s'en dégager, de grands maîtres (usurpateurs) ont inventé la pensée positive, phénomène toujours réducteur et naïf pour un esprit libéré en acte plutôt qu'en projet. Ce qui relève d'une acrobatie malaisée à exécuter sans tomber dans les contradictions. La haine est le moteur de la vie chez Sapiens, souvent cachée, recouverte d'un voile de mystère qui empêche l'individu de s'y attaquer frontalement. Y a pas que de l'amour... Elle est pratiquement impossible à vraiment éluder dès lors qu'il s'agit de poser un jugement de valeur. Les gens, catégorie abstraite, sont l'excuse du chaland pour vernir sa fierté. I fucked my way up to the top mais j'ai au moins ça, les gens, ma haine à leur endroit, pour ne pas sombrer dans les dépressions les plus pénibles. Après tout, qu'ai-je vraiment accompli de si nouveau ou de si courageux autre que parler de moi sur tous les tons ? Je suis une tache dans le mur, je n'ai fait qu'apprivoiser mes dix mille pensées pour les rendre dicible, et encore pas toujours de façon bien claire. Je n'éclaire rien, pire, je brouille les pistes pour ceux qui veulent partir à ma recherche. A quel moment suis-je censé mettre de l'ordre dans ce piètre chaos ? La haine, encore, me pousse à l'étendre jusqu'à-ce qu'il devienne une nébuleuse qui n'admet que ses propres lois. Ici, dans le texte. Mes réflexions sur ce que peut, sur ce que doit être ma littérature n'ont depuis longtemps fait que lâcher les chiens sur celle, vaste et richement fournie, qui n'a pour seul mérite que d'exister. Je l'avoue bien modestement, l'aristocrate en moi a des velléités de prendre le pas sur ma raison. Je le contient, je le réserve aux bonnes occasions, et parfois il m'est utile. C'est un démon, une créature cynique et froide. Mais j'entretiens avec elle un rapport de confraternité indéfectible. Et je me résous à être insultant, arrogant et verbeux quand il s'agit de parler de moi-même. Je me déteste. Néanmoins pas encore assez. Je suis un trublion sans destin, planqué dans un coin du web à la vue des angry-few qui sautent le pas de venir me lire.
Que faire de notre condescendance ? Doit-elle brûler dans le désert, à la vue de la poussière seulement ? La vie de mes mots est sans doute la source de ma stratégie de l'échec. Nonobstant son inanité chronique, elle me conforte dans ce qui apure de plus vil et dédaigneux en moi. Les comptes sont faits, je n'ai aucun pouvoir sur un nombre qu'on pourrait renseigner de mes stéréotypes. C'est dans les eaux troubles de mes turpitudes les plus absconses qu'on trouvera, malgré tout, les perles qui annoncent mon désir de faire pénitence. Il n'est pas encore question de cesser d'être aware des tares de monsieur-et-madame-tous-les-autres, plurivoques et connectées, mais simplement de faire un instant machine-arrière pour voir à quel nous sommes pompeux et infréquentables. C'est le privilège de l'auteur que de magnifier les parts les plus sombres en lui et le reste de la création. J'abjure mon obsession scripturale qui n'a de réel intérêt que de nous perdre dans un jeu de miroirs où l'on ne sait plus qui critique qui. Et à quel véritable dessein... Pourtant j'avance, je l'écris avant que ma mémoire l'ait occis définitivement de ma mémoire friable. C'est un luxe que je m'offre, cette capacité à coller pêle-mêle des phrases qui manifestent souvent une situation de hors-sujet. Peut-être parce qu'il n'y a pas de véritable sujet, que le titre de ce dernier texte vous a tous trompés et qu'il n'y a aucune pensée théorique intelligemment agencée, juste les élucubrations d'un personnage surfait et suffisant. Grand bien me fasse, je vois que vous êtes encore là. Quelqu'un sait-il le long de combien de phrases il faut errer pour faire naître la possibilité de gagner le droit d'être cité hors-contexte ? Les gens le savent, ils le diront tous : leur présence est en croissance géométrique. Le jeu prend ainsi forme dans l'idée qu'une critique vaut mieux que mille applaudissements et, en même temps, qu'un pillage de nos lubies mises en phrases plus que le silence de la circonspection générale. La haine en moi trahit son existence dans ces lignes, alors que, IRL, elle ne le fait qu'avec mesure et prudence. Elle est vive parce que je l'entretiens, je n'ai plus de désir d'écriture ce soir que raconter ma défaite inéluctable. Et vous êtes toujours là, à suivre un raisonnement un peu baroque qui trouvera son terme uniquement dans la folie.
Fâchons-nous, trouvons des portes de sortie à cette auto-satisfaction qui bride notre être-moral vers l'impiété la plus grande à l'encontre de nos consciences abîmées par le ressac de la vie moderne. La haine est notre compagne sur le chemin de l'objectivité. Nous ne sommes que péchés devant la vérité et le curé aura tôt fait de nous le faire comprendre. Est-ce un idéal théologique que le dénigrement de soi-même ? On pourra le penser. Et après, on reprendra la querelle des universaux comme si elle n'avait pas pris fin avec OK Computer de Radiohead en 1997. Mes arrangements sont des signifiants sans signifié. Comme ils sont troubles, ils sont sans conséquence. De quelle expérience suis-je le fruit ? Celle d'un vol probablement... une histoire de piraterie et d'achats compulsifs de livres lus au mieux à moitié. Un survol sans valable profondeur. La punition, que je m'offre d'être improductif le reste du temps, la plus lapidaire. Vous serez juges de savoir s'il faut ou pas en retenir quelque chose. Vous me condamnerez et peut-être que je le mériterai, défait par une haine qui aura, malgré la contrition, réussi à s'exprimer. Les gens me condamneront. Il n'y aura pas de Dieu pour me gracier. Mon insomnie n'aura servi à rien. Quel vertige ! Au milieu de cette haine il pourrait y avoir quelques échantillons d'une capacité d'adaptation au milieu et un début d'espoir en l'intelligence pluriforme qui habite encore une partie de l'humanité. Il doit en exister qui méritent d'être suivis, par le charisme et la raison, mais, comme les gens, je ne connais que moi. On fera la liste des choses qui nous énervent, on la portera au pinacle de la même façon qu'on s'érigera en sauveur du monde puis on s'anéantira de nouveau dans notre solitude en rentrant sagement à la maison. Que faire de sa haine est le problème central de l'ère numérique et il existe quantité de manières d'y répondre, notamment en laissant un commentaire acerbe au pied du post d'une vidéo de chatons. Gratuitement. Pour le sport. Après tout, que sont-ils venus pourrir mon scroll en cette matinée ? On me les a imposés et je n'ai pas pu m'empêcher de les regarder, comme si j'avais été manipulé. Ils sont apparus de façon sauvage dans l'idée délibérée de me faire perdre cinq bonnes minutes. Je le vois encore, ils me hantent, me filent la haine. J'ai la haine. Je la déverse sans autre objectif que de me vider avec rigueur. J'écris. Puis ça passe. Un grand verre d'eau fait son office, bientôt recouvert d'un café et d'une cigarette. La police des mœurs me surveille peut-être, alors je commence à envisager de manger un morceau, pour flatter la haine qui surnage au fond de mon estomac contrarié. Tout renvoie à la haine... La haine est partout. La haine est notre alliée fidèle. Et il n'y a souvent rien de mieux à faire que d'y succomber. Que la messe soit dite, qu'il ne reste rien du corps du Christ que son sang coagulé en tache sur notre chemise avinée.